1866 – 1869, Crise. 1
Les poèmes « parnassiens ». 2
Déclenchement et résolution de la crise. 3
Hérodiade. 4
Une nouvelle poétique. 5
Le Beau. 6
Sonnet allégorique de lui-même. 7
Disposons sur notre table de travail les Poésies de Mallarmé (par exemple, celles commentées par Benichou dans son livre Selon Mallarmé), la Correspondance complète (par exemple, celle éditée par Bertrand Marchal), ses Divagations et autres textes (Igitur – Divagations – Un Coup de dés, toujours éditées et commentées par Bertrand Marchal), et les grandes biographies que lui ont consacré Henri Mondor (Vie de Mallarmé) et Jean-Luc Steinmetz (L’absolu au jour le jour).

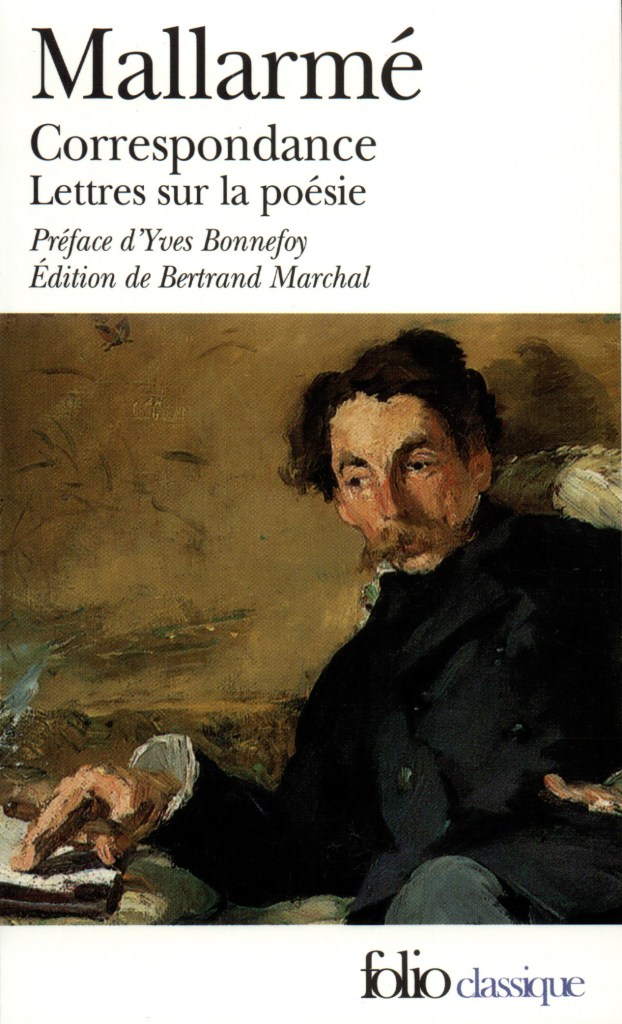



En parcourant ces livres, on peut constater qu’à en rester à la lecture de ses Vers, voire de ses textes en prose (tels La Musique et les Lettres, Le Mystère dans les Lettres, Crise de vers, et ses différentes interviews), le lecteur risque de rater quelque chose, risque de rater notamment la césure entre les poèmes écrits avant 1866 et ceux écrits après 1869.
1866 – 1869, Crise
En effet, entre 1866 et 1869, Mallarmé traverse une crise fondamentale, crise qu’il décrit à ses amis Cazalis, Lefébure, Aubanel, Villiers de l’Isle-Adam. Pendant cette période de profond ébranlement psychique, il n’écrit aucun nouvel alexandrin. Il a certes tenté de poursuivre l’écriture de certains vers, ceux d’Hérodiade ou ceux de l’Après midi d’un faune, mais n’a — il le dit explicitement — pas fait un « alexandrin pendant 24 mois »[i].
Ses poèmes d’avant 1866, « Les Fenêtres », « L’Azur », « Apparition », « Las d’un amer repos… », « Brise marine », « Don du poème », sont, comme nous l’a montré Paul Benichou dans son magnifique Selon Mallarmé, d’allure baudelairienne, et reprennent bon nombre de thèmes romantiques. Par contre, ceux d’après 1869, sont tout autre, et assez incompréhensibles. Le premier poème que Mallarmé écrit après cette « crise » est précisément un poème dont le sens a été aboli, un poème « réduit » à de pures sonorités, « Sonnet allégorique de lui-même », dont Mallarmé lui-même doute qu’il ait un sens. De cette période date le Mallarmé « obscur ».
Or, en lisant les biographies qu’Henri Mondor et que Jean-Luc Steinmetz lui ont consacrées, et en lisant sa correspondance de 1862 à 1871, que Bertrand Marchal a annotée, on constate que Mallarmé traverse une crise psychique, une crise mentale, une crise intellectuelle, une crise qu’il nomme lui-même crise « hystérique », crise qui ne trouvera sa « solution » qu’en 1869, « the crisis is over », et où il parlera alors de « reconstitution du moi ».
Les poèmes « parnassiens »
Posons-nous d’abord la question de savoir s’il est si pertinent de comparer les poèmes « parnassiens » de Mallarmé aux poèmes de Baudelaire ? Il me semble que non. Car de quoi est-il question dans Les Fleurs du mal ?
Lisons quelques poèmes de Baudelaire. Y est-il question d’impuissance, de douleur liée à un Idéal inaccessible ? Si oui, ce n’est pas prioritaire, ni déterminant. Dans bon nombre de poèmes de Baudelaire, il est surtout question de caresses sensuelles, de jouissance sexuelle, de la beauté du corps des femmes. Par ailleurs, d’autres poèmes font équivaloir la femme jadis aimée à un déchet, à une « ordure », à un « ossement », à une « charogne », à un cadavre « baiser de vers »…
Chez Mallarmé, on ne trouve pas cette efflorescence de poèmes consacrés à l’amour, à la sensualité, à la jouissance du corps de femmes aimées. Ni à son rabaissement. Bien au contraire, lorsqu’on parle d’influence baudelairienne dans ses poèmes parnassiens, il me semble que l’on pense surtout à l’impuissance du poète à rejoindre l’Idéal. Or cette touche est plutôt rare dans l’ensemble des poèmes de Baudelaire.
Effectivement, si nous lisons les poèmes « parnassiens » de Mallarmé, Les fenêtres, L’Azur, Apparition, « Las de l’amer repos… », Brise marine, Don du poème, série de poèmes écrits avant 1866, qui précèdent le fameux sonnet en X, « Sonnet allégorique de lui-même », écrit après la crise, après 1868, nous constatons qu’il y est surtout question de découragement, de désespoir, d’ennui, de dégoût à l’égard de cet homme à l’âme dure satisfait de sa vie matérielle, de vomissement qu’il éprouve face à la bêtise d’ici-bas, d’aspiration vers l’Au-delà, vers l’Invisible. Que lui reste-t-il à faire, dès lors, sinon à fuir, là-bas… vers l’Azur.
Déclenchement et résolution de la crise
Essayons de cerner les moments de déclenchement de sa « crise de la page blanche ». Il en parle clairement à différents destinataires : Henri Cazalis, Théodore Aubanel, Henri Lefébure, Villiers de l’Isle-Adam.
Ensuite, Mallarmé nous parle des points d’appui qu’il a trouvés dans certains textes théoriques, qui lui ont permis, au bout de trois ans, de sortir de cette crise. Là, les lettres à Lefébure, Villiers de l’Isle-Adam et Léon Diercx le disent explicitement : ce sont le livre de Descartes, Le discours de la méthode, et le livre de Max Müller, La science du langage, qui lui ont permis de traiter cette crise.
Et alors seulement, il se remet à l’écriture.
Mettons en série les lettres qui cernent le déclenchement de la crise psychique de 1866, celles où il parle de son épuisement mental, et celles où il dit avoir trouvé une solution.
Hérodiade
Mallarmé raconte dans une première lettre, très importante, envoyée à son ami Henri Cazalis, le 28 avril 1866, une expérience vécue trois mois auparavant, en janvier ou février 66. A ce moment-là, il fait une expérience effrayante : « En creusant le vers », en écrivant un poème consacré à une femme, à Hérodiade (« grenade ouverte », « chair de la femme », « rose cruelle », dit-il ailleurs), à l’Autre sexe, sexe insymbolisable, la Femme associée à la décollation, il fait l’épreuve de « l’Abîme », du « Néant », du « vide ».
Cette expérience aura un double effet, à la fois sur lui en tant que sujet, et sur la poétique qu’il est en train d’inventer.
Ce premier abîme rencontré, il le nomme : Néant. Il s’agit effectivement d’une épreuve de néantisation du sujet. Stéphane est devenu « impersonnel », il est mort, « parfaitement mort ». Il n’est plus là en tant que sujet. Plus tard, il parlera d’agonie, d’horrible sensibilité, d’épuisement physique, d’absence cataleptique, d’âme détruite, de vide absolu, de destruction de soi, de désagrégation de son être, de perte de raison, et, dans un texte théorique plus tardif, il parlera de « disparition élocutoire du poète ».
Sa « pensée s’est pensée », sa pensée s’est noyée dans l’Obscur Déluge, il est emporté dans les Ténèbres absolues, il est tombé dans les griffes du Monstre, dans la gueule vacante du Monstre qui le dévore.
Nous avons affaire ici à la description d’un effondrement du sujet. Il tombe dans le trou. Les points d’appui qu’il avait trouvés précédemment s’effondrent.
Il est vide, néant, mort, impersonnel. — Côté sujet.
Il a affaire à l’Obscur Déluge, aux Ténèbres absolues, au Monstre dévorant. — Côté Autre.
Une nouvelle poétique
Il n’en reste pas là. Il trouve une issue.
Il trouve, il invente. Une mutation subjective est à la source de sa nouvelle poétique.
A Aubanel, il écrit le 16 juillet 66 : « Je suis mort et ressuscité avec la clef de pierreries de ma dernière Cassette spirituelle. »[ii]
Le 20 décembre 66, quasi un an après la crise, il écrit à Armand Renaud : « Je ne me suis pas encore retrouvé spirituellement. » Mais il poursuit par une phrase étonnante :
« J’ai infiniment travaillé cet été, à moi d’abord, en créant, par la plus belle synthèse, un monde dont je suis le Dieu, — et à un Œuvre qui en résultera, pur et magnifique, je l’espère. Herodiade […] sera une des colonnes torses, splendides et salomoniques, de ce Temple. Je m’assigne vingt ans pour l’achever, et le reste de ma vie sera voué à une Esthétique de la Poésie… »[iii]
Retenons cette expression : « Un monde dont je suis le Dieu. »
Mais c’est une autre lettre, une longue lettre à Cazalis du 14 mai 1867, un an et demi après la crise, qui nous éclaire sur sa mutation subjective. Il reparle de l’effroi qu’il a éprouvé, de l’agonie, de la mort, de l’horrible sensibilité, du néant, etc. Il parle de sa pensée qui s’est pensée et qui est arrivée à une Conception pure. Mais il parle surtout de son combat avec l’Autre, d’un nouveau rapport à cet Autre : « C’est t’apprendre que je suis maintenant impersonnel, et non plus le Stéphane que tu as connu, — mais une aptitude qu’a l’Univers à se voir et à se développer, à travers ce qui fut moi. Fragile comme est mon apparition terrestre, je ne puis subir que les développements absolument nécessaires pour que l’univers trouve, en ce moi, son identité. Ainsi, je viens à l’heure de la synthèse, de délimiter l’œuvre qui sera l’image de ce développement. [C’est-à-dire : Trois poèmes en vers, l’Ouverture d’Hérodiade… et quatre poèmes en prose sur la conception spirituelle du Néant]. »[iv]
N’assistons-nous pas ici à l’élaboration d’une solution qu’il trouve à sa crise ? N’y a-t-il pas là un point d’invention — il est devenu une « aptitude qu’a l’Univers de se voir, de se développer », bref, il se fait missionnaire de l’Autre, il s’invente un « Moi » à partir duquel l’Univers peut se voir, peut se développer, et se dire poétiquement, un « Moi » où l’Univers peut trouver son identité.
Cette invention, il la nomme : une « Synthèse suprême »[v].
Ne peut-on ainsi comprendre cette phrase adressée à Villiers de l’Isle-Adam, en septembre 67 : « J’avais, à la faveur d’une grande sensibilité, compris la corrélation intime de la Poésie avec l’Univers, et, pour qu’elle soit pure, conçu le dessein de la sortir du Rêve et du Hasard, et de la juxtaposer à la conception de l’Univers. »[vi]
Ainsi, après avoir bordé cet Abîme rencontré, après avoir triomphé du combat avec l’Ange et s’être reconstitué un « Moi » à partir duquel l’Univers pourra se dire poétiquement, il pourra élaborer alors une nouvelle poétique. Et pourra dire qu’après avoir rencontré le Néant, il a rencontré le Beau.

Mais la reconstitution du « Moi » de Mallarmé doit cependant encore se soutenir d’un miroir, d’une « glace de Venise ». Après la description de sa lutte avec le vieux et méchant plumage, il poursuit : « Jusqu’à ce qu’enfin je me sois revu dans ma glace de Venise. […] J’avoue du reste […] que j’ai encore besoin […] de me regarder dans cette glace pour penser, et que si elle n’était pas devant la table où je t’écris cette lettre, je redeviendrais le Néant. [Mallarmé avait raturé : ‘Je retomberais dans le Néant.’]»
Comme si le Moi de Mallarmé devant la glace s’était substitué à la mort du sujet. Et se soutenant de ce Moi-là, il pourra alors s’inventer un nouvel Autre : non plus le Monstre qui le dévore, mais un Univers qui se voit et se développe, voire trouve son identité, au travers de ce nouveau Moi mallarméen et de sa nouvelle poétique.
Le Beau
« Je suis en train de jeter les fondements d’un livre sur le Beau. Mon esprit se meut dans l’Éternel, et en a eu plusieurs frissons. »[vii]
« Je voyage dans des pays inconnus, et si, pour fuir la réalité torride, je me plais à évoquer des images froides, je te dirai que je suis depuis un mois dans les plus purs glaciers de l’esthétique — qu’après avoir trouvé le Néant, j’ai trouvé le Beau. »[viii]
Mallarmé dressera alors une série d’opposition : Oui le Beau s’est substitué au Néant. Mais c’est aussi un « Glorieux mensonge » qui couvre le Rien.
Comment caractériser cette nouvelle poétique qu’il invente, et en quoi est-elle en relation avec cet Abîme qu’il a rencontré en 1866 ?
Il a trouvé un point d’appui dans le livre de Descartes, Le discours de la Méthode : il voit la pensée se pensant et se donnant à elle-même les règles de la pensée droite. De même, avec la lecture du livre de Max Müller, La science du langage, il découvre la science linguistique, c’est-à-dire la langue se parlant à elle-même, et découvrant ses propres lois.
Le premier poème qu’il écrit au sortir de sa crise, c’est le « Sonnet allégorique de lui-même », première version du Sonnet qui perdra ensuite son titre, dans la version de 1887, et sera alors désigné comme le « Sonnet en X » ou « Sonnet en IX ».
Sonnet allégorique de lui-même
La Nuit approbatrice allume les onyx
De ses ongles au pur Crime, lampadophore,
Du Soir aboli par le vespéral Phoenix
De qui la cendre n’a de cinéraire amphoreSur des consoles, en le noir Salon : nul ptyx,
Insolite vaisseau d’inanité sonore,
Car le Maître est allé puiser de l’eau du Styx
Avec tous ses objets dont le Rêve s’honore.Et selon la croisée au Nord vacante, un or
Néfaste incite pour son beau cadre une rixe
Faite d’un dieu que croit emporter une nixeEn l’obscurcissement de la glace, décor
De l’absence, sinon que sur la glace encor
De scintillations le septuor se fixe.
Le « Sonnet allégorique de lui-même », comme son titre l’indique, c’est une pure réflexivité, c’est un sonnet qui renvoie à lui-même, dont les mots renvoient aux mots du sonnet, et non aux mots de l’extérieur dans une quête de signification. Sonnet qui ne s’intéresse qu’à lui-même, qu’à ce qui fait sa matière, d’en-deçà du sens, hors sens.
De la version ultime, celle de 87, vingt ans donc après sa première version, Mallarmé dira : « J’extrais ce sonnet, auquel j’avais une fois songé cet été, d’une étude projetée sur la Parole : il est inverse, je veux dire que le sens, s’il en a un, (mais je me consolerais du contraire grâce à la dose de poésie qu’il renferme, ce me semble) est évoqué par un mirage interne des mots mêmes. En se laissant aller à murmurer plusieurs fois on éprouve une sensation assez cabalistique. »[ix]
A partir de 1868 donc, sa poésie se développe en jeu sonore, en purs sons, où le sens se trouve aboli et où le signifiant lacanien trouve sa définition mallarméenne : « Insolite vaisseau d’inanité sonore » qui deviendra « Aboli bibelot d’inanité sonore » : « nul Ptyx ». C’est bien le réel propre à la jouissance du signifiant qui est ici visé.
Bref, quelle est son invention d’écriture ? Sa nouvelle poétique ne vise plus le sens. Sous ses poésies, Mallarmé fait sentir un « Miroitement en dessous », « scintillation », « reflet » — effet de sens lié au scopique qui ramène au jour (dans l’invention du nom) l’objet-voix.
Jean-Claude Encalado
[Texte établi par Véronique Müller]
Notes
[i] Lettre à Lefébure du 3 mai 1868.
[ii] Folio, p. 312.
[iii] Folio, p. 335.
[iv] Lettre du 14 mai 1867, à Henri Cazalis, Folio, p. 343.
[v] Folio, p. 342.
[vi] Folio, p. 366.
[vii] Lettre à Cazalis, de mai 66, p. 305.
[viii] Cazalis. 13 juillet 66. Folio, p. 310.
[ix] Lettre à Henri Cazalis, du 18 juillet 1868, Folio, p. 392.

Cher Jean-Claude,
Forte présentation, merci, encore et toujours ! La crise est parfaitement discernée, y compris sa dimension créatrice…
N’oublions pas que les mots dépendent de leur usage : est-ce que pour nous le sens n’est pas à différencier de la signification ? Même dans le « Coup de dés », je ne crois pas qu’il n’y ait que pure sonorité, mais son qui fait sens – à tous les sens du sens, y compris celui du rien (de signification) qui n’est pas rien de sensation, de sens du « hasard », entre autres…
Amitié,
Eric
>